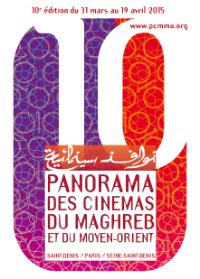Vous auriez 1 minute pour nous ?
Après 20 ans d’existence, nous entamons la refonte de notre base de données consacrée aux films qui questionnent la société.
Aidez-nous à l’améliorer en remplissant ce rapide questionnaire.
Temps de réponse estimé : 1 minute seulement !
Promis : aucune donnée personnelle ne sera collectée !
Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
Saint-Denis – mai
• @ : panocinemaghrebmoyenorient@gmail.com
À l’origine du Panorama, une ambition aux désirs multiples !
Permettre à une cinématographie émergente, encore peu diffusée en France, de rencontrer un public et se faire connaître.
Parier sur sa capacité à transformer une perception par fois caricaturale de la culture musulmane et arabe en permettant la découverte de films à la fois passionnants, novateurs, et singuliers, aux thèmes d’une très riche diversité.
Révéler la richesse culturelle d’une ville, Saint-Denis, sa diversité, sa complexité. Associer ses habitants en les impliquant dans la manifestation, comme acteurs et spectateurs de l’événement. La population d’origine maghrébine est nombreuse en France, et particulièrement dans cette ville. Ce panorama est aussi un moyen de lui donner à voir et à entendre la richesse de sa culture, contribuant ainsi à une certaine forme de reconnaissance de son identité et de ses racines.
Le Panorama est un rendez-vous « cinématographique, festif et familial » ; des rencontres et des échanges ont lieu autour de projections de films entre des réalisateurs, professionnels du cinéma et le public venu de toute l’Ile-de-France et au delà.
Le Panorama assemble plusieurs manifestations et animations culturelles (concert, brunch littéraire…).
36 films dans la base
-
Fatima Sissani, 2014
Six jeunes femmes, proches de la trentaine. Elles sont nées dans le même immeuble de la cité des Mordacs à Champigny-sur-Marne. Elles ne se sont pas quittées depuis l’enfance. Une relation fusionnelle. Elles racontent, joyeuses et à toute vitesse, cette amitié presque amoureuse et aussi l’identité, les rapports de classe, la relégation spatiale, sociale… À travers le portrait d’une bande de copines, drôles, joyeuses, énergiques mais aussi lucides et émouvantes, voici un regard juste sur la banlieue qui s’éloigne des clichés habituels.
-
Anna Roussillon, 2014
En janvier 2011 en Égypte les manifestations anti-gouvernementales rassemblent des dizaines de milliers de personnes dans les rues du Caire, tandis que les villageois des campagnes du Sud suivent les évènements de la Place Tahrir via leurs écrans de télévision et les journaux. Du renversement de Moubarak à l’élection de Mohamed Morsi, le film suit ces bouleversements politiques du point de vue d’un village de la vallée de Louxor. Entre espoirs et déceptions, le changement se fait attendre.
-
Ayat Najafi, 2014
En Iran, depuis la révolution islamique de 1979, le régime interdit aux femmes le droit de chanter en public si elles le font en solo et devant des hommes. L’auteure-compositrice Sara Najafi tient à changer les choses.
-
Nassima Guessoum, 2014
À Alger, Nassima Hablal, héroïne oubliée de la Révolution algérienne, raconte son histoire de femme dans la guerre, sa lutte pour une Algérie indépendante.
-
Nadine Naous, 2014
A la suite des difficultés financières de son père, directeur d’une école progressiste dans la banlieue sud de Beyrouth zone d’influence du Hezbollah, la réalisatrice retourne au Liban. En famille, les discussions fréquentes et souvent drôles, sont animées. A partir de ces confrontations se dessinent l’histoire récente du pays et la façon dont les changements politiques ont irréversiblement transformé la société.
-
Hélène Crouzillat, Laëtitia Tura, 2014
Du Sahara à Mellila, des témoins racontent la façon dont ils ont frôlé la mort, qui a emporté leurs compagnons de route, migrants littéralement et symboliquement engloutis dans la frontière.
-
Mohamed Amin Benamraoui, 2013
Le Rif, 1975. Amar, 10 ans, vit seul avec son oncle, violent et buveur, depuis que sa mère, veuve, est partie se remarier en Belgique. Avec Carmen, réfugiée espagnole fuyant le franquisme, il découvre le cinéma. Bientôt, les premières tensions entre le Maroc et l’Espagne se profilent…
-
Chant des tortues (Le). Une révolution marocaine
Jawad Rhalib, 2013
Le 20 février 2011 voit le début de la révolution marocaine. Des jeunes que l’on disait dépolitisés, sans idéaux, vont, sous la bannière du « mouvement du 20 février », faire sortir dans la rue des centaines de milliers de Marocains, habités par l’exigence de la liberté et de la justice.
-
Hicham Lasri, 2013
L’histoire de Majhoul, emprisonné en 1981 pendant les émeutes du pain au Maroc, qui ressort 30 ans plus tard, en plein printemps arabe. Une équipe de télévision publique qui réalise un reportage sur les mouvements sociaux au Maroc décide de le suivre dans la recherche de son passé.
-
Sophie Zarifian, Simon Desjobert, 2013
Quelques jours après la chute de Moubarak, Hana, Égyptienne de 18 ans, cherche sa voie - et sa voix- dans la révolution en cours.
-
Axel Salvatori-Sinz, 2012
À Yarmouk en Syrie, camp de réfugiés palestiniens, les Chebabs sont un petit groupe de garçons et de filles qui se connaissent depuis l’adolescence. Aujourd’hui, ils ont une véritable soif de vivre et d’absolu, mais sont confrontés à des réalités complexes.
-
Meyar Al Roumi, 2012
Le seul endroit où Walid, chauffeur de taxi à Damas, peut échanger un baiser en privé avec sa fiancée Suhair, est dans sa voiture. Alors quand celle-ci est invitée à Téhéran par un ami, ils décident de s’y rendre ensemble en train ; ils pourront enfin profiter l’un de l’autre…
-
Haifaa Al-Mansour, 2012
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles…
-
Sarah Tikanounine, 2012
Les jeunes footballeuses de l’équipe nationale algérienne de football féminin témoignent des difficultés qu’elles rencontrent à exercer librement leur sport, du regard des hommes, des préjugés de ces derniers et de la société dans laquelle elles vivent.
-
Merzak Allouache, 2012
Algérie région des hauts plateaux. Alors que des groupes d’irréductibles islamistes continuent à semer la terreur, Rachid, un jeune jihadiste quitte la montagne et regagne son village. Selon la loi de « pardon et de concorde nationale », il doit se rendre à la police et restituer son arme. Il bénéficie alors d’une amnistie et devient « repenti ». Mais la loi ne peut effacer les crimes et pour Rachid s’engage un voyage sans issue où s’enchevêtrent la violence, le secret, la manipulation.
-
Brahim Fritah, 2012
Le film s’inspire des souvenirs d’enfance de son auteur, Brahim, 10 ans en 1980 et nous plonge avec tendresse dans son quotidien, entre l’école et les copains, la TV et l’usine, où son père, d’origine marocaine, est gardien. Ancrée dans un contexte économique et social en mutation, la fin d’une ère industrielle et glorieuse marquée par une désindustrialisation et des délocalisations, cette période est également synonyme de transformations pour le jeune Brahim.
-
Tinghir-Jérusalem, les échos de Mellah
Kamal Hachkar, 2012
De retour au Maroc le réalisateur cherche à comprendre ce que sont devenus les juifs, berbères comme lui, qui habitaient son village natal… Tinghir. Pour mieux approcher ce phénomène du départ, le réalisateur est allé à la rencontre de ces juifs marocains qui ont décidé de vivre en Israël.
-
Comme si nous attrapions un cobra
Hala Al Abdalla, 2012
Comme si nous attrapions un cobra dessine le paysage des aspirations démocratiques des peuples du monde arabe en pleins bouleversements révolutionnaires en s’appuyant sur la parole et l’art des caricaturistes. La liberté d’expression est l’aspiration la plus visible de cette lame de fond, le dessin de presse l’incarne par sa distance critique et son humour.
-
Lamine Ammar-Khodja, 2012
C’est un « Cahier de retour au pays natal » qui commence le 6 janvier 2011, date de déclenchement des émeutes populaires à Alger. Quand on revient après huit années d’absence, la question qui se pose est : comment trouver une place parmi les siens ? Mais le train est en marche et les questions existentielles vont s’entremêler avec l’actualité politique bouillonnante de la région.
-
Safinez Bousbia, 2012
El Gusto, raconte avec émotion et… bonne humeur comment la musique a réuni ceux que l’Histoire a séparés il y a 50 ans, au cœur de la Casbah d’Alger.
-
Ali Essafi, 2011
Les années soixante-dix au Maroc. Les révoltes étudiantes revendiquent liberté et démocratie. Pour échapper aux arrestations de masse, Azziz accepte de vivre sous une fausse identité.
-
Fatima Sissani, 2011
La réalisatrice filme sa mère, et, à travers elle, pose un regard sur la langue Kabyle. Cette langue, c’est l’ultime bagage que des milliers d’émigrants kabyles ont emporté avec eux… Une langue pour se construire un ailleurs qui ne soit pas que l’exil.
-
Comment recadrer un hors-la-loi en tirant sur un fil
Lamine Ammar-Khodja, 2010
Un Algérien dyslexique rencontre un manouche sur un banc bleu, une Algérienne dans un champ vert, un Allemand ou un Turc au milieu de ruines. Au lieu d’un film sur l’identité, il comprend « lis ton idée ». Non loin, traîne le débat sur l’identité nationale.
-
Laurent Chevallier, 2009
Deux Marocains tentent un pari fou : créer, en plein désert, une pépinière pour empêcher les jeunes paysans de leur région de céder aux mirages de l’émigration.
-
Meriem Bouakaz, 2008
Pourquoi veulent-ils tous partir coûte que coûte, acceptant tous les risques, malgré les dangers qu’ils savent terribles ? Qu’est ce qui les pousse à fuir leur pays ? Pourquoi sont-ils toujours plus nombreux à choisir cette voie ? Que cherchent-ils, qu’espèrent-ils y trouver ? Quel est donc ce rêve pour lequel ils sont prêts à mourir ?
-
Malek Bensmail, 2008
Le 1er novembre 1954, près de Ghassira, un petit village perdu dans les Aurès, un couple d’instituteurs français et un caïd algérien sont les premières victimes civiles d’une guerre de sept ans qui mènera à l’indépendance de l’Algérie. Plus de cinquante ans après, Malek Bensmaïl revient dans ce village
-
Alexandra Dols, 2007
Ce documentaire retrace des engagements de femmes dans les luttes pour l’Indépendance de l’Algérie, au sein du FLN-ALN (Front de Libération Nationale – Armée de Libération Nationale) à travers des récits de vies d’anciennes combattantes.
-
Hala Mohammad, 2006
2006, avant la révolution syrienne. Trois amis, des prisonniers d’opinion, ont croupi pendant des années dans la prison de Palmyre. Pour la première fois depuis leur libération, ils reviennent vers cette prison où ils ont tant souffert…
-
Michel Ocelot, 2006
Un conte d’animation qui nous emmène à la rencontre de deux jeunes hommes, bercés, lorsqu’ils étaient enfants, par la même femme : nourrice de l’un,maman de l’autre. Après une séparation brutale, ils sont devenus des étrangers l’un pour l’autre. pourtant, ils nourrissent ensemble le même rêve : retrouver la fée des Djinns, héroïne des histoires qu’on leur racontait, enfants…
-
Tariq Teguia, 2006
Durant plus de dix années, l’Algérie a vécu une guerre lente, une guerre sans ligne de front mais ayant causé plus de 100 000 morts. C’est ce désert que Zina et Kamel – deux jeunes algérois tantôt hallucinés et joyeux, tantôt abattus et sereins – voudront sillonner une dernière fois avant de le quitter.
-
Mehdi Charef, 2006
Le dernier printemps de la Guerre d’Algérie. Le printemps d’avant l’été de l’Indépendance. Ali, 11 ans, et son meilleur copain Nico regardent leurs mondes changer… et font semblant de croire que Nico ne partira jamais. Jamais ?
-
Ismaël Ferroukhi, 2004
Réda est un jeune homme sur le point de passer son bac dans le sud-est. Parce que son frère s’est vu retirer son permis de conduire, c’est à lui que le père impose un sacrifice : il doit le conduire en voiture à la Mecque. Les deux hommes – que tout sépare – partent donc pour un long périple à travers l’Europe, autant d’occasions de disputes, de timides rapprochements et de rencontres étonnantes.
-
Chronique des années de braise
Mohammed Lakhdar-Hamina, 1975
Chronique évenementielle de l’histoire de l’Algérie de 1939 a 1954, date du déclenchement de la lutte armée. Le film s’articule autour de deux axes fondamentaux : l’expropriation des terres et la déculturation. Il montre en quoi le 1er novembre 1954 est l’aboutissement de la lutte multiforme du peuple algérien pour résister à la colonisation, depuis ses débuts. Palme d’or, Cannes 1975.
-
Avoir vingt ans dans les Aurès
René Vautier, 1972
1961. De jeunes soldats bretons se retrouvent dans le Sud Algérien pour participer à la guerre d’Algérie. Tous se mettent à piller, tuer et violer, sauf Noël Fravelière, hostile à cette guerre et qui refuse de se battre. Il est abattu après avoir libéré un prisonnier algérien.
-
Yann Le Masson, 1961
Film réalisé à partir de dessins d’enfants algériens recueillis dans un camp en Tunisie.
-
René Vautier, 1958
Vautier a réalisé en 1957 L’Algérie en flammes dans les maquis du F.N.L., avant de devenir directeur du Centre audiovisuel d’Alger qu’il crée en 1962, où il forma de nombreux réalisateurs, et aussi responsable de la formation de réalisateurs au Sahara.